L'aménagement et la recherche s'inscrivent dans un contexte de banalisation de la participation des acteurs, en particulier dans le domaine de l’environnement. Cette tendance forme l'élément fondateur de cette recherche en géographie. Parmi les démarches d'accompagnement de la démocratie environnementale, la géoprospective se définit comme une modalité de scénarisation à long terme, collective et spatialisée qui repose largement sur l'utilisation de modèles spatio-temporels. Cette thèse avance que la géoprospective peut également constituer un outil heuristique de la contribution de l'espace et du temps à la démocratie environnementale, à plusieurs niveaux, et notamment celui de l’ancrage dans l’espace et le temps de la participation, celui des objets spatio-temporels produits par la participation ainsi que celui de la portée socio-politique de la référence à l’espace et au temps de la participation. Afin de tester ces hypothèses, une série de motivations conduisent à appliquer une démarche géoprospective aux pêches maritimes du golfe de Gascogne, caractérisées par exemple par la singularité de leurs dimensions spatio-temporelles, par la centralité du pouvoir de gestion et par la hiérarchisation des types de savoirs environnementaux. Le dispositif développé pour explorer les hypothèses de recherche combine plusieurs méthodes participatives, d’une part d’enquête par entretiens et d’autre part de modélisation (selon une définition étendue de la notion de modèle). L’analyse des matériaux narratifs collectés permet d’abord d’affiner la connaissance sur les dimensions spatio-temporelles des pêches maritimes et sur la variabilité de leur perception selon les acteurs. La recherche menée met ensuite en évidence les charges affectives et symboliques contenues dans les modèles qualitatifs destinés à un usage participatif. Enfin, un travail de réflexivité sur l’exercice mis en œuvre permet de discuter la capacité de la participation à modifier, reconduire ou reproduire le pouvoir et le savoir des acteurs.
Research and publish the best content.
Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
Already have an account: Login
Ressources scientifiques et techniques sélectionnées par les documentalistes du Service Documentation L@Doc : Ressources - Formation - Appui à la recherche - Institut Agro Rennes-Angers : Ecologie marine, aquaculture, gestion des pêches, produits de la mer, gestion du littoral,sciences halieutiques
Curated by
Agrodoc Ouest
 Your new post is loading... Your new post is loading...
|







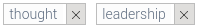


Thèse en version électronique disponible à cette adresse
CV et publications de Laure Tissière disponibles à cette adresse